NaufrageCivilisations AminMaalouf by Unknown
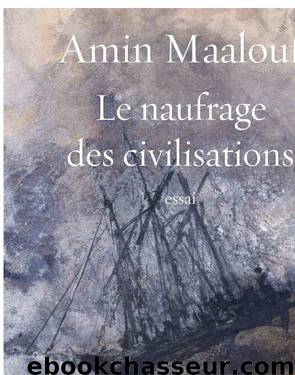
Auteur:Unknown
La langue: eng
Format: epub
Publié: 2019-04-15T06:24:00+00:00
Ces quatre bouleversements majeurs, qui s’étaient succédé en tout juste sept mois, d’octobre 1978 à mai 1979, mais dans des environnements culturels et sociaux fort éloignés les uns des autres, avaient-ils quelque chose en commun en dehors de la simple « coïncidence » chronologique ? Est-il concevable que la Curie romaine et le Comité central du Parti communiste chinois, les électeurs britanniques et les manifestants iraniens, aient pu réagir à une même impulsion ?
Avec le recul, je vois principalement deux facteurs qui ont pesé sur l’atmosphère de ces années-là, qui ont affecté, à des degrés divers, tous les pays du monde, et qui ont pu jouer un rôle dans la genèse des quatre événements que je viens d’évoquer. L’un est la crise terminale du régime soviétique ; l’autre est le choc pétrolier.
S’agissant de ce dernier facteur, j’y reviendrai plus longuement dans des chapitres à venir ; je voudrais juste dire ici qu’il a contraint toutes les nations de la planète à s’interroger sur la gestion de leur économie, sur leurs lois sociales, comme sur leurs rapports avec les pays exportateurs de pétrole ; et que pour ceux-ci, qui appartenaient dans leur majorité au monde arabo-musulman, ledit
« choc », qui aurait dû assurer leur bonheur, s’est révélé dévastateur, et finalement calamiteux.
S’agissant du premier facteur, il m’apparaît aujourd’hui que nombre d’événements de cette époque-là constituaient des réactions plus ou moins directes, plus ou moins conscientes, plus ou moins réfléchies, aux agissements de « l’homme malade » qu’était devenu le régime soviétique. Un très étrange
« malade » qui se voyait encore débordant de vigueur, et croyait ses adversaires aux abois.
*
Quand on se replonge dans les années soixante-dix, on ne peut s’empêcher de trouver pathétique le spectacle de cette superpuissance lancée à corps perdu dans une stratégie de conquêtes, sur tous les continents, alors que sa propre maison, sur laquelle flottaient les étendards ternis du socialisme, du progressisme, de l’athéisme militant et de l’égalitarisme, était déjà irrémédiablement lézardée, et sur le point de s’écrouler.
Pour qui se fiait à l’apparence des choses, l’Union soviétique semblait voler de triomphe en triomphe. Au Vietnam, où le monde communiste et le monde capitaliste s’étaient affrontés sans répit dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit était arrivé à son terme en avril 1975. La partie sud du pays, qui avait constitué jusque-là une république séparée soutenue par les États-Unis, fut
conquise par les forces venues du nord, avec le soutien du mouvement communiste local, qui s’appelait lui-même Front national de libération, mais que les Américains appelaient Viet Cong.
Jeune journaliste fasciné comme tant d’autres par ce conflit si emblématique pour ma génération, je m’étais rendu à Saigon afin d’assister à la bataille décisive. Je savais que l’on s’approchait de l’épilogue, mais je n’imaginais pas que les choses allaient évoluer aussi vite. Le 26 mars, jour de mon arrivée, les troupes communistes venaient de prendre Hué, l’ancienne capitale impériale ; une semaine plus tard, elles étaient déjà aux abords de Saigon, sept cents kilomètres plus au sud. Et il était clair que leur progression allait se poursuivre jusqu’au bout.
Je n’avais perçu dans la capitale du Sud aucune volonté de résistance. C’était plutôt la résignation, et même le sauve-qui-peut. Tous ceux qui craignaient la rigueur du régime à venir cherchaient désespérément un moyen de quitter le pays. Du jour au lendemain, la monnaie locale, la piastre, cessa d’avoir cours, plus aucun commerçant n’en voulait. Dans les administrations publiques, on décrochait à la hâte les photos officielles du dernier président sud-vietnamien, le général Thieu, qui s’apprêtait lui-même à partir, et qui allait finir sa vie paisiblement dans le Massachusetts, oublié de tous.
Saigon tomba le 30 avril. Ceux qui ont connu cette époque gardent en mémoire ces scènes pathétiques où des civils et des militaires, réfugiés à l’ambassade américaine, cherchaient à s’accrocher aux derniers hélicoptères pour s’enfuir. Images plus humiliantes encore pour les sauveteurs que pour les rescapés. La « République du Vietnam », que plusieurs présidents américains s’étaient engagés à défendre, fut annexée à la République socialiste du Vietnam, et sa capitale rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville, du nom du dirigeant qui avait défié avec succès la France puis les États-Unis.
Deux semaines plus tôt, Phnom Penh, capitale du Cambodge, avait été prise par des insurgés communistes ; puis ce fut au tour du Laos. La fameuse théorie des dominos, selon laquelle un pays qui tombe en entraîne un autre dans sa chute, puis un autre encore, semblait à l’œuvre. Et l’Union soviétique en était la principale bénéficiaire.
Ce phénomène ne se limitait d’ailleurs pas à l’Indochine. En Afrique, par exemple, où les anciennes puissances coloniales européennes occupaient traditionnellement une place prépondérante, les rapports de force commençaient à changer rapidement. Quand le Portugal, après la « révolution des Œillets »
d’avril 1974, décida de donner l’indépendance à ses colonies, les cinq nouveaux
États africains qui virent aussitôt le jour furent tous dirigés par des partis d’obédience marxiste ; le plus riche d’entre eux, l’Angola, appela même Fidel Castro à sa rescousse pour faire face à une insurrection, et les troupes cubaines, soutenues par Moscou, débarquèrent par dizaines de milliers sur les côtes africaines à partir de novembre 1975, sans que les États-Unis puissent s’y opposer.
Ainsi, dans les mois qui ont suivi leur victoire hautement symbolique dans le conflit vietnamien, les Soviétiques avaient enregistré des avancées spectaculaires sur un continent qui apparaissait jusque-là comme une chasse gardée des Occidentaux. Les pays de l’Afrique subsaharienne qui se réclamaient désormais du marxisme étaient de plus en plus nombreux – outre l’Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao-Tomé-et-Principe, il y avait Madagascar, le Congo Brazzaville, la Guinée Conakry… Il y eut même un bref moment où, dans la corne de l’Afrique, les deux principaux pays, l’Éthiopie et la Somalie, étaient gouvernés par des militaires se réclamant du marxisme-léninisme, tandis que, sur l’autre rive de la mer d’Arabie, le Yémen du Sud, État indépendant dont la capitale était Aden, s’était proclamé « république démocratique populaire »
sous l’égide d’un parti de type communiste, doté d’un politburo.
C’est dans cette atmosphère d’expansion débridée et de franche euphorie que les dirigeants soviétiques se sont lancés dans une aventure qui se révéla désastreuse et même fatale pour leur régime : la conquête de l’Afghanistan.
Ce pays montagneux, situé entre l’Iran, le Pakistan, la Chine et les républiques soviétiques d’Asie centrale, comptait des mouvements d’obédience communiste, actifs et ambitieux, mais très minoritaires au sein d’une population musulmane socialement conservatrice et farouchement hostile à toute ingérence étrangère.
Laissés à eux-mêmes, ces militants n’avaient aucune chance de tenir durablement les rênes du pouvoir. Seule une implication active de leurs puissants voisins soviétiques pouvait modifier le rapport de force en leur faveur. Encore fallait-il que lesdits voisins soient convaincus de la nécessité d’une telle intervention.
C’est justement ce qui arriva à partir du mois d’avril 1978.
Télécharger
Ce site ne stocke aucun fichier sur son serveur. Nous ne faisons qu'indexer et lier au contenu fourni par d'autres sites. Veuillez contacter les fournisseurs de contenu pour supprimer le contenu des droits d'auteur, le cas échéant, et nous envoyer un courrier électronique. Nous supprimerons immédiatement les liens ou contenus pertinents.
Le chant de Wren 01 Marquée by Addison Cain(2658)
Histoires pornographiques by Q'Abé Valentine(2651)
Le Glee magazine by littlesitter(2277)
Fait maison n°1 by Cyril Lignac(2140)
Antoine Marcas T05 La Croix des Assassins by Giacometti et Ravenne(2128)
Le petit traité Rustica de la pâtisserie maison - Plus de 100 recettes faciles (Les petits traités) (French Edition) by Martine Soliman(2048)
À la recherche du temps perdu 15 XV Le temps retrouvé 2 by Marcel Proust(1987)
Le Roman des Croisades T1 La Croix et le Royaume by Michel Peyramaure(1987)
À la recherche du temps perdu 05 V À l’ombre des jeunes filles en fleurs 3 by Marcel Proust(1959)
Les Micro-humains by Bernard Werber(1952)
La croix de Saint-Georges by Kent Alexander(1919)
Marianne T2- et l'inconnu de Toscane by Juliette Benzoni(1907)
Cal DONOVAN 01 Le livre de la croix by Cooper Glenn(1893)
Le Maître ou le tournoi de go by Kawabata Yasunari(1734)
LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS by Farallon Islands(1704)
The Lying Game T5 , Crois de bois croix de fer by Sara Shepard(1699)
La cité des rêves by Don Winslow(1674)
Dans le murmure des feuilles qui dansent (A.M. ROM.FRANC) (French Edition) by Agnès Ledig(1594)
Substance secrète by Reichs Kathy(1537)
